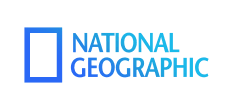Comme les cétacés n'ont pas de poils recouvrant leur peau, celle-ci est plus exposée aux coupures et aux abrasions que la peau des autres mammifères, ce qui se traduit par un nombre élevé de cicatrices visibles. Chez les cétacés, ces cicatrices restent blanches ou non pigmentées et peuvent être causées par une grande variété de blessures telles que des accidents, des parasites, des prédateurs ou des combats intraspécifiques (McCann, 1974). Ces cicatrices sont particulièrement fréquentes chez les cétacés de la famille des Odontocètes (baleines à dents), à laquelle appartient le cachalot.
Que vous soyez un passionné de la mer, un biologiste ou un simple curieux de ces géants des océans, découvrez les histoires gravées dans la peau du cachalot et apprenez à mieux comprendre leur existence fascinante.

Cicatrices de la lutte intraspécifique
En cachalotsChez les cachalots, on sait que certaines cicatrices, souvent disposées en parallèle, proviennent de combats intraspécifiques entre mâles. Ces cicatrices sont perçues comme un indicateur de la "qualité" du mâle (MacLeod, 1998).
Les proies du cachalot sont principalement des céphalopodes. Ils n'ont donc pas besoin de dents, ce qui leur a permis d'évoluer en tant qu'armes de combat. Il en résulte une importance accrue de la qualité de la signalisation. Cela permet d'éviter les risques d'escalade dans les rencontres agressives entre individus inégalement assortis (MacLeod, 1998).
Ces cicatrices commencent à apparaître au moment de la maturité. Elles indiquent l'âge, les animaux plus âgés et plus grands étant plus marqués (Kato, 1984). Ces individus ont tellement de cicatrices qu'elles se chevauchent.
Consultez tous nos articles sur la faune et la flore uniques des Açores: État de conservation des dauphins | Dauphins roses | Le thon dans le régime alimentaire des dauphins | Capacités olfactives des dauphins | Reproduction des baleines et des dauphins | Les baleines sont-elles carnivores ? | Le sperme de baleine rend-il l'océan salé ? | Communication entre baleines et dauphins | Comment dorment les baleines et les dauphins ? | Quelle est la durée de vie des baleines ? | Combien de temps une baleine peut-elle retenir sa respiration ?
Cicatrices dues aux ventouses des calmars géants

En revanche, les cicatrices circulaires sont le résultat de luttes avec des cachalotsSa principale proie : le calmar géant. Ce motif circulaire correspond aux vigoureuses ventouses qui tapissent les bras et les tentacules du calmar.
Face à ces énormes céphalopodes, on pense qu'ils utilisent leur tête pour les frapper, après les avoir saisis avec les mâchoires, ce qui a pour effet d'imprimer les tentacules sur la région faciale du cachalot (McCann, 1974).
Utilisation des cicatrices dans l'identification photographique

On ne sait pas si ces cicatrices ont un effet sur la structure sociale des cachalots, mais pour nous, elles sont bénéfiques pour notre travail de photo-identification. La photo-identification nous permet de déterminer le nombre d'individus dans un groupe, d'étudier le cycle de vie des animaux et d'identifier les différents groupes autour des Açores.
Consultez tous nos articles sur la faune et la flore uniques des Açores: Vitesse de nage des baleines | Capacité respiratoire des baleines bleues | Comportement d'accouplement des dauphins | Noms collectifs pour les dauphins | Top 3 des faits et curiosités sur les dauphins | Régime et habitudes alimentaires des dauphins | Statut de conservation du rorqual commun | Régime alimentaire du cachalot | Cicatrices du cachalot | À quoi ressemble le pénis d'une baleine ? | Quel est le goût du lait de baleine ? | Méduse portugaise Man-o'-War | Que mangent les baleines ? | Peut-on entendre les baleines au-dessus de l'eau ?
Conclusion
Lorsque vous voyez les cachalots se reposer à la surface de l'eau, ils peuvent sembler de gentils géants, mais les cicatrices sur leur corps nous racontent une toute autre histoire : ce sont en fait de grands combattants !
Décidément, les cicatrices rendent ces animaux beaucoup plus identitaires, ce qui nous permet aussi de mieux les connaître par photoID et de compléter notre catalogue de cachalots dans l'archipel !
Vous souhaitez connaître les meilleures périodes pour observer les baleines ?
Jetez un coup d'œil à notre calendrier de l'observation des baleines et planifiez votre prochaine aventure ! Ne manquez pas la chance d'apercevoir ces créatures majestueuses dans les eaux açoriennes. 🐋 🌊
Références
- Kato, H. (1984). Observation des cicatrices dentaires sur la tête du cachalot mâle, en tant qu'indicateur de l'état de santé de l'animal.
indication d'un combat intra-sexuel. Sci. Rep. Whales Res. Inst. Tokyo 35 : 39±46 - MacLeod, C. D. (1998). Intraspecific scarring in odontocete cetaceans : an indicator of male
La "qualité" dans les interactions sociales agressives ? Journal of Zoology, 244(1), 71-77. - McCann, Charles. (1974). Body scarring on Cetacea-odontocetes